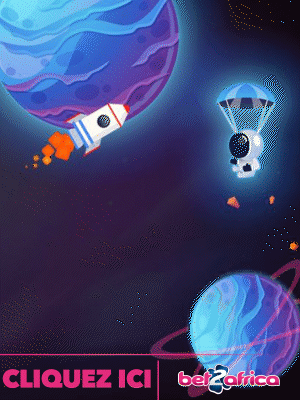Le 10 janvier 2025, Siadous Rapono Erwan Bradyn et Nounamo Christ Anderson comparaîtront devant une cour criminelle spéciale pour mineurs, après avoir été inculpés pour viol et meurtre sur la personne de Ngoua Michelle Dorothée. Ces événements tragiques, survenus dans la nuit du 8 au 9 août 2023 au quartier Sociga, soulèvent des interrogations profondes sur le respect des droits fondamentaux dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Des aveux sous la torture ?
Placés sous mandat de dépôt à la Prison centrale de Libreville dès le 14 août 2023, les deux adolescents, alors âgés respectivement de 16 et 17 ans, ont rapidement fait des aveux publics sur la première chaîne de télévision nationale. Mais ces aveux, réalisés sous l’effet présumé de la torture, posent la question de leur validité. Interpellés et détenus sans accès à leurs parents ni à un avocat pendant cinq jours, les jeunes accusés auraient subi des sévices physiques et psychologiques pour les contraindre à se confesser.
Dans un État de droit, la pratique de la torture est illégale, tout comme l’exploitation médiatique de déclarations obtenues par la contrainte. Ces méthodes rappellent des dérives incompatibles avec le principe de la présomption d’innocence, pourtant garanti par la Constitution gabonaise et les conventions internationales.
Des preuves mystérieusement absentes
Une autre zone d’ombre entoure les vidéos de surveillance qui auraient été récupérées par les forces de l’ordre. Ces enregistrements, cruciaux pour établir la vérité des faits, n’ont jamais été inclus dans le dossier. Plus inquiétant encore, ils semblent avoir tout simplement disparu. Comment expliquer une telle négligence dans une affaire aussi grave ? Cette absence fragilise le travail d’enquête et nourrit les doutes sur l’impartialité des procédures engagées.
Par ailleurs, l’enquête aurait été des plus simples si la police avait procédé à des prélèvements ADN ou des empreintes. De telles analyses auraient permis de confondre ou d’innocenter sans contestation les présumés coupables. Une question se pose dès lors : nos officiers de police judiciaire (OPJ) sont-ils réellement formés pour mener des enquêtes dans le respect des standards modernes et efficaces ?
Des détentions arbitraires ?
Après huit mois de détention, les deux adolescents avaient été remis en liberté provisoire. Cependant, sous la pression d’un tollé médiatique, Anderson a été à nouveau arrêté et incarcéré. Selon ses proches, il aurait passé 17 jours enchaîné au tribunal de Libreville, un traitement inhumain qui défie toute logique judiciaire et humaine.
Ces éléments soulignent une question cruciale : la justice gabonaise peut-elle concilier la nécessité de punir les actes criminels avec le respect des droits humains, notamment ceux des mineurs ?
La torture : une pratique hors la loi
L’usage de la torture dans le cadre de procédures judiciaires est formellement proscrit. Pourtant, des cas comme celui des frères Rapono et Nounamo montrent qu’elle persiste en dépit des lois en vigueur. La gravité de ces accusations devrait pousser les autorités gabonaises à mener des enquêtes indépendantes pour établir les responsabilités et sanctionner les coupables, qu’ils soient membres des forces de l’ordre ou de l’administration judiciaire.
Un procès sous haute tension
Le procès à venir sera scruté de près, tant par les citoyens que par les organisations de défense des droits humains. Au-delà des faits reprochés, c’est l’ensemble du système judiciaire qui est sur la sellette. Le Gabon, qui se revendique comme un État démocratique, doit démontrer sa capacité à respecter les droits fondamentaux de tous, y compris ceux des présumés coupables.
Dans cette affaire, une justice équitable et transparente est plus que jamais nécessaire, non seulement pour rendre hommage à la mémoire de Ngoua Michelle Dorothée, mais aussi pour restaurer la confiance dans les institutions et garantir que de telles dérives ne se reproduisent plus.