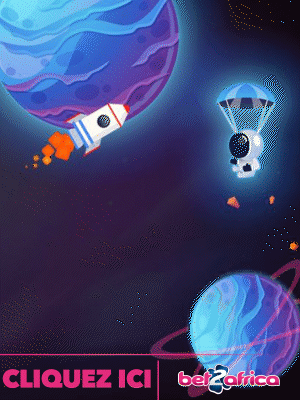À peine adoptée, la nouvelle Constitution, censée incarner les valeurs de justice et de respect des droits fondamentaux, est déjà foulée aux pieds par les forces de sécurité et de défense. C’est le constat alarmant qui découle des récents abus subis par des citoyens dans le cadre de l’opération coup de poing menée dans le Grand Libreville.
Lancée officiellement pour lutter contre le grand banditisme qui gangrène la capitale et ses environs, cette opération conjointe des forces armées s’est rapidement muée en une série de dérives graves, oscillant entre torture et humiliations publiques. Plus de 340 personnes ont été arrêtées, souvent dans des conditions qui heurtent la dignité humaine. Ces interpellations, assorties de traitements dégradants, constituent une violation flagrante de l’article 12 de la nouvelle Constitution, qui interdit toute forme de traitement inhumain ou dégradant.
Parmi les témoignages glaçants qui circulent, un détail particulièrement choquant revient avec insistance : l’utilisation d’un seul rasoir et d’une seule paire de ciseaux pour raser ou couper les cheveux des personnes interpellées, sans aucune désinfection préalable. Cette pratique, digne d’une autre époque, représente un danger sanitaire évident, notamment dans un contexte où plus de 2000 personnes séropositives sont actuellement hors du radar des programmes nationaux de lutte contre le VIH. Des images diffusées sur les réseaux sociaux dévoilent des blessures provoquées par ces outils non stérilisés, amplifiant l’indignation collective.
Face à ces actes, une question se pose : en quoi ces citoyens représentent-ils une menace pour l’intégrité des institutions au point de mériter un tel traitement ? Ces abus traduisent une dérive inquiétante dans l’application des mesures sécuritaires, où la lutte contre l’insécurité semble servir de prétexte à des atteintes flagrantes aux droits humains.
Dans un contexte déjà tendu, marqué par un couvre-feu qui perdure depuis plus de 15 mois sans justification claire, l’indignation des populations monte. Sur les réseaux sociaux comme dans les discussions quotidiennes, les Gabonais expriment leur ras-le-bol. « Le 30 août n’était donc pas la libération du Gabon. Depuis, nous vivons dans une prison à ciel ouvert », s’indigne un internaute.
Ce climat d’oppression et de méfiance renforce l’impression d’un décalage entre les promesses de renouveau portées par les autorités et la réalité vécue par les citoyens. Si la lutte contre le banditisme est une priorité, elle ne saurait justifier le mépris des droits fondamentaux. À l’heure où les institutions gabonaises cherchent à regagner la confiance des populations, de telles pratiques ternissent davantage l’image de l’État et alimentent le sentiment de frustration générale.
Il est urgent que les autorités prennent la mesure de la gravité de ces actes. L’État, garant des droits et libertés, doit non seulement rappeler les forces de sécurité à l’ordre mais aussi initier des enquêtes pour faire la lumière sur ces dérives. Dans un Gabon qui aspire à se reconstruire, le respect de la dignité humaine ne peut être sacrifié sur l’autel de la sécurité. La confiance des citoyens ne se gagne pas par la coercition, mais par la justice et le respect des valeurs républicaines.