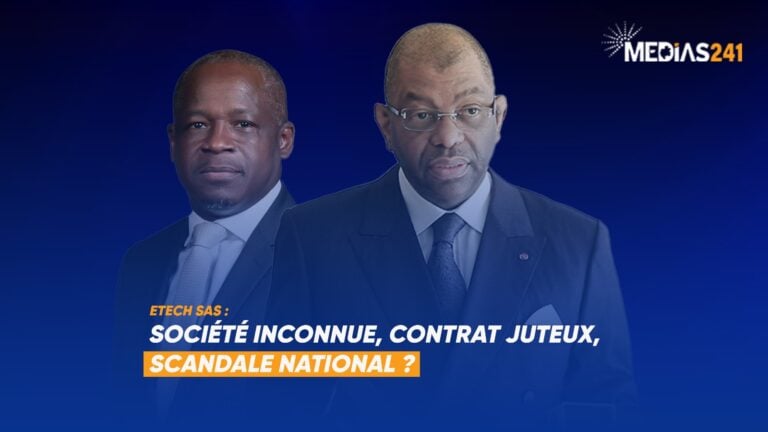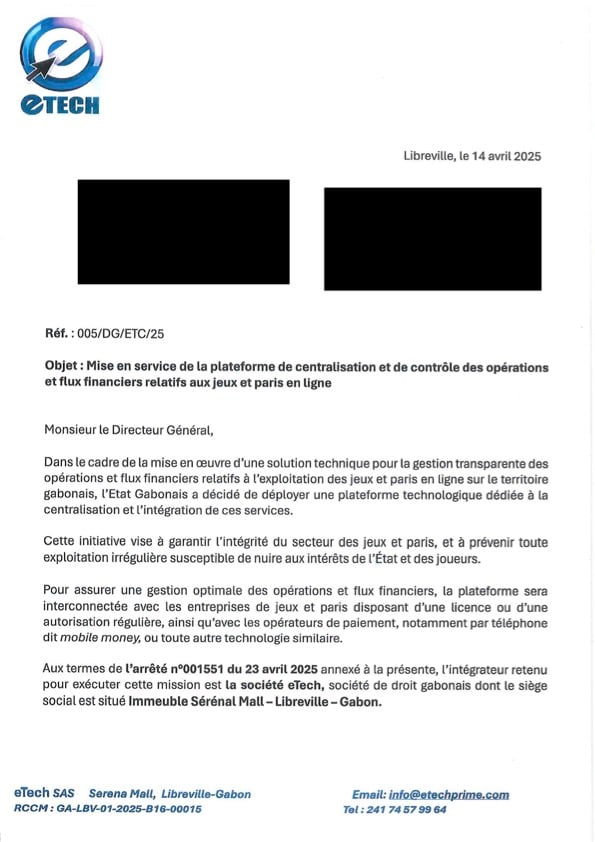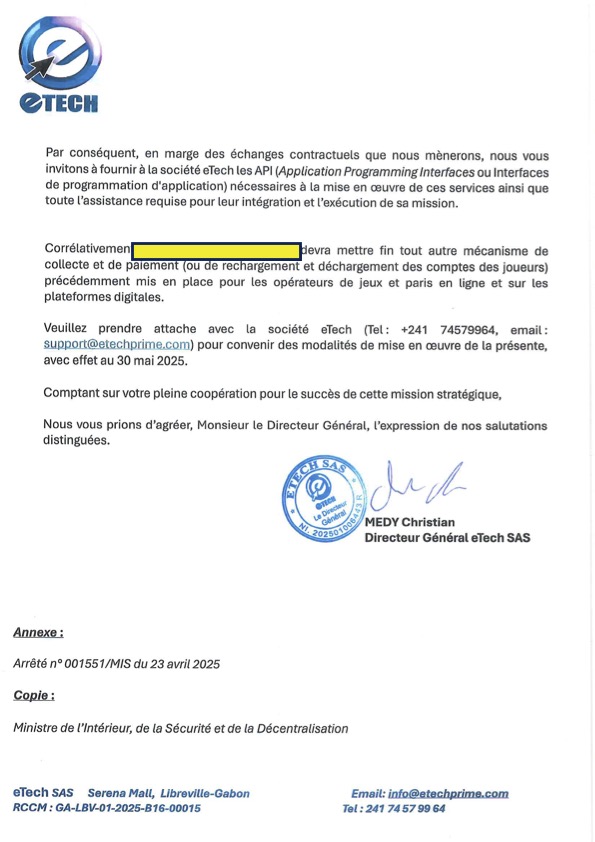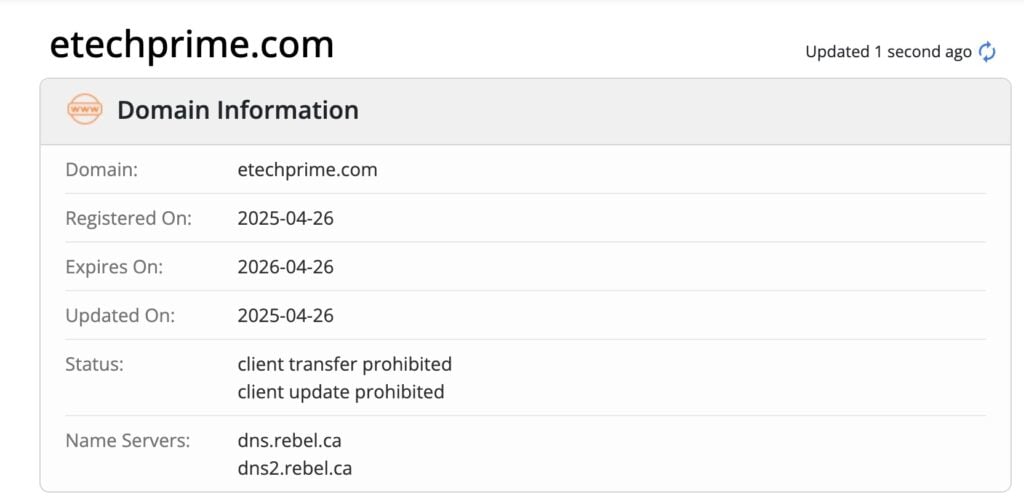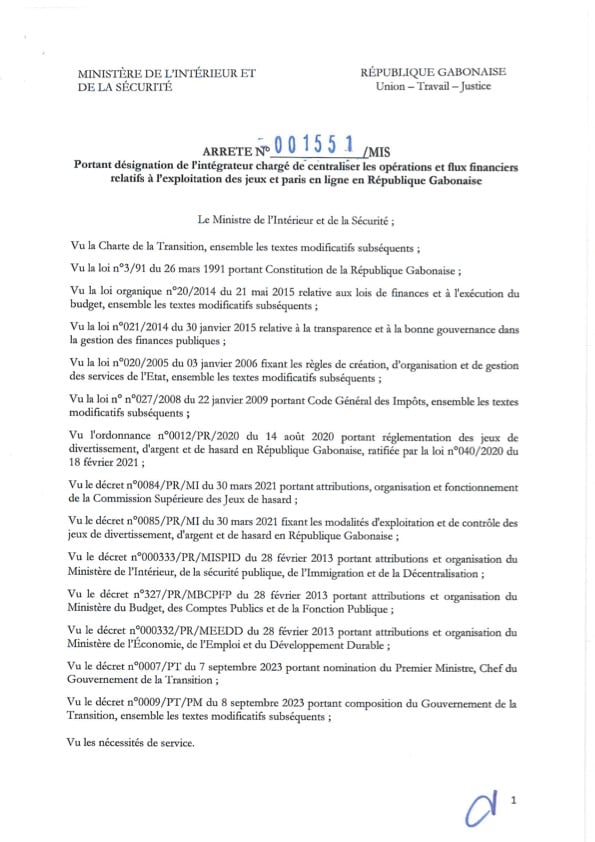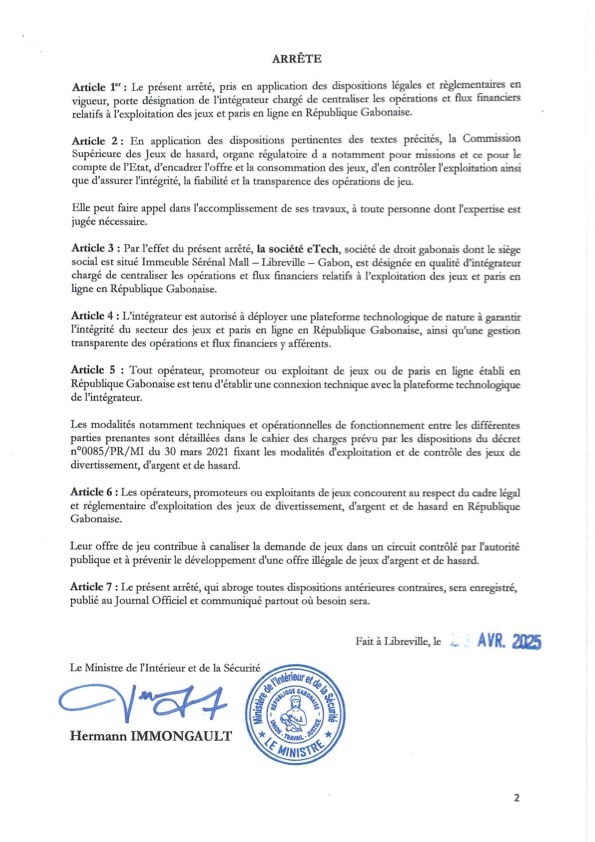Depuis son arrivée à la tête de l’Agence Nationale des Bourses du Gabon (ANBG) en novembre 2023, le Professeur Ruphin Ndjambou a engagé une réforme d’une rare rigueur pour moraliser une institution longtemps gangrenée par les pratiques mafieuses et les détournements massifs. Ce combat frontal contre les réseaux d’intérêts installés au cœur même de l’appareil administratif n’est pas sans conséquences : la riposte des anciens profiteurs est aussi violente que sournoise.
Pendant des années, l’ANBG a fonctionné à contre-emploi. D’agence de soutien à la formation des jeunes Gabonais, elle était devenue, sous certains régimes internes, un guichet opaque où les bourses s’achetaient comme des marchandises : 5 millions pour les États-Unis, 3 millions pour l’Europe, 2 pour l’Afrique, et 1 million pour le Gabon. À la manœuvre : des agents internes complices de réseaux externes, parfois liés à des agences de voyages créées de toutes pièces pour détourner les frais de scolarité. Des cas d’étudiants fictifs avec des frais allant jusqu’à 26 millions de francs CFA par an ont été documentés.
Le Professeur Ndjambou a brisé cette mécanique. Le réseau de ventes de bourses est désormais démantelé, les enquêtes judiciaires ouvertes, et plusieurs noms cités. Cette purge, nécessaire, a bousculé les intérêts établis. Des agents encore en poste, nostalgiques des pratiques d’antan, mènent aujourd’hui une cabale médiatique et institutionnelle contre le nouveau DG. Mais les faits sont têtus.
Au-delà du nettoyage des écuries d’Augias, Ndjambou a lancé une série de réformes majeures :
Création de délégations extérieures pour une meilleure gestion locale des bourses à l’étranger, limitant les rétro-commissions et les surfacturations.
Mise en place de délégations intérieures pour permettre aux étudiants vivant à l’intérieur du pays de gérer leurs dossiers sans devoir se déplacer à Libreville.
Réduction des coûts de prestations par l’assainissement des contrats avec les prestataires et la fin des monopoles douteux.
Ces mesures ont entraîné une réduction significative des dépenses, tout en améliorant la qualité du service rendu aux étudiants. Une politique en phase avec les très hautes instructions du president pour la restauration des institutions.
Rigoureux. Méticuleux. Pragmatique. Concentré. Le style Ndjambou tranche avec l’impunité passée. Lui-même le dit souvent : « Je fais mon travail, et c’est le Trésor public qui paie les bourses après les ordres de paiement envoyés par l’ANBG. » Ce respect scrupuleux des procédures a asséché les sources de revenus illicites. Et cela dérange.
Certains, dans l’ombre, cherchent désormais à bloquer les nouvelles réformes, y compris au sein même du Conseil des ministres, où un texte-clef est subitement resté en suspens, malgré son adoption en amont. Une question s’impose : qui est derrière ce blocage ? Quels intérêts tente-t-on de préserver au détriment de la transparence et de l’équité ?
La justice sociale passe aussi par la justice administrative. Et à l’ANBG, un homme s’emploie à la rendre possible. Pour le bien de tous. Mais surtout, pour le respect du contribuable gabonais.